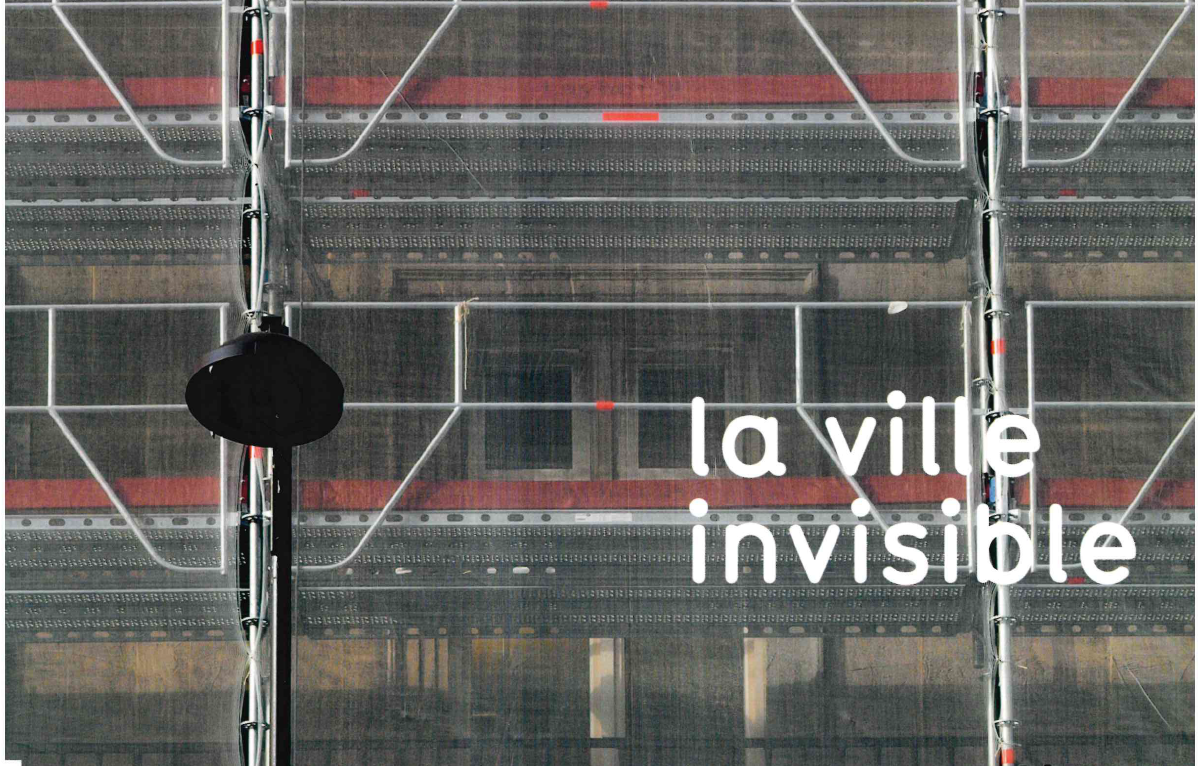La rénovation urbaine de la banlieue ne date pas d’hier. L’urbanisation de la périphérie est perpétuellement ressentie comme récente, précipitée, exclusivement dédiée à l’économie, qu’elle soit industrielle ou commerciale, en contrepoint du centre, lieu stratifié de l’histoire et de la culture.
Cette appréhension imprime dans les consciences l’idée d’une ville coupée en deux. Si les noyaux anciens font l’objet d’attentions diverses, les faubourgs demeurent le lieu de tous les possibles urbains, de toutes les tentations dérogatoires, destinées aux cobayes de l’architecture expérimentale et autres déréglementations métropolitaines. Au bout du compte, le paysage de la banlieue ne bénéficie pas d’une valeur reconnue pour son identité propre et sa mémoire, mais inspire largement le sentiment d’un inachèvement chaotique nécessitant un vigoureux remaniement.
Ainsi, sous la pression renouvelée du Grand Paris ou autres “éco-quartiers”, les métamorphoses attendues des communes du nord-est parisien découlent d’une approche aussi radicale qu’amnésique, rappelant étrangement un mode de planification d’un autre temps. Dans cette optique, revenir sur une page de l’histoire récente de Saint-Denis à travers l’opération de la “ZAC Basilique”, à l’examen de ses réussites et de ses échecs ou encore du jeu des acteurs d’alors, n’est pas sans éclairer le mode actuel de fabrication de la ville sur ce même territoire, ceci à l’aube de la grande mutation métropolitaine parisienne.
Un quartier “rénové”
Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les abords immédiats de la basilique de Saint-Denis, seuil de l’art gothique et nécropole des rois de France, font l’objet de réflexions tentant de traiter les affres urbaines de l’insalubrité, à savoir un bâti congestionné et dégradé où s’enchevêtrent des logements paupérisés et des ateliers. Des années 1950 aux premières réalisations du quartier actuel s’égrèneront des visions urbaines successives, sous l’axe constant d’une éradication des îlots situés au nord de la basilique. Les différents projets établis par André Lurçat, puis Serge Lana et Serge Magnien, ses anciens assistants, et enfin par une pléiade d’architectes coordonnés par la Sodedat, la SEM du département, vont tour à tour convoquer les thèses du moment : de l’hygiène fonctionnelle des barres dégageant le sol et le monument en fluidifiant la circulation automobile, jusqu’à la recomposition d’une morphologie “historique”. Cette dernière tendance revendique une urbanité retrouvée, selon les théories émergeant en France dans les années 1970, lesquelles rejettent la mise en forme urbaine et sociale des “grands ensembles” dont le territoire avait été largement pourvu. Durant près de trois décennies se joue la genèse politique et théorique du projet, dans le contexte d’un suivi resserré de l’État et de sa Direction du patrimoine, gardienne contre-révolutionnaire des sépultures royales englobées dans l’expansion industrielle du XIXe siècle, face à une municipalité ouvrière soucieuse de faire valoir ses prérogatives en urbanisme et sa vision militante d’une architecture politiquement engagée dans l’innovation et le social.
Entre le métro étiré depuis Paris en 1976 jusqu’au tramway en 1992, les opérations découpées par “îlots” offrent aujourd’hui l’image d’un quartier spécifique de la ville, identifiable par sa morphologie et son architecture. Cet ensemble constitue le manifeste d’une période transitoire qui perdure aujourd’hui, affichant toutes les velléités d’une rupture avec l’urbanisme étatique des Trente Glorieuses tout en prolongeant certains de ses aspects. Objet de débats dès sa genèse, la ZAC Basilique constitue une pièce de l’histoire urbaine française, enthousiasmante par la dynamique des points de vue relayés par la presse spécialisée d’alors et la fraîcheur des réflexions théoriques qui l’ont animée, aux antipodes du cynisme économique, ou plutôt financier, des pratiques actuelles.
Certes, le foisonnement architectural du quartier expose nombre d’individualités créatives et autonomes. Cependant, sans pour autant converser entre eux, les bâtiments s’accordent et participent à la délimitation des espaces non bâtis de la ville définis comme des “passages”, des “rues” et des “places”, attachés à la relation au lieu par la préservation de points de vue vers la basilique. Ainsi, les îlots bordant la rue principale forment un tracé à la sinuosité médiévale revendiquée que complètent, de part et d’autre de la voie, des arcades formant les “collatéraux d’une nef à ciel ouvert” recoupés d’une série de perspectives rayonnant vers le monument. De la même manière, le maintien de passages et galeries continus d’un bâtiment à l’autre permet, avant leur fermeture successive, la traversée piétonne du quartier par les intérieurs d’îlots.
Ce plan d’ensemble, qui résulte de la coordination assurée par Guy Naizot et Eva Samuel, sous l’égide de la Sodedat pilotée par Jean-Pierre Lefebvre, a fondé et institutionnalisé un renouveau du dialogue entre architectes ; ceux-ci étaient rompus depuis l’après-guerre au monologue à grande échelle en modelant des opérations de centaines ou milliers de logements. Plus subtile, cette coordination spatiale s’accompagne d’une articulation des programmes avec l’intégration aux opérations de logements d’une grande surface en rez-de-chaussée, d’un hôtel, d’une résidence pour personnes âgées, de commerces, de bureaux, d’administrations. L’inventaire à la Prévert d’un véritable centre-ville aux fonctionnalités réintégrées, au moment où l’aménagement par table rase s’assimile à l’éclatement sectorisé des programmes en limite des franges urbaines.
Un catalogue sur un plateau
Œuvre collective mais également addition juxtaposée d’écritures d’auteurs alors en pleine ascension : Roland Simounet, Bernard Paurd, Jean et Maria Deroche, Renée Gailhoustet, Francis Gaussel, Jacques Bardet, Olivier Girard, Georges Maurios… jusqu’à des grands noms de professionnels reconnus dans les derniers projets, tels Henri Gaudin et Oscar Niemeyer. L’expression, que chacun s’amusera à reconnaître, va de l’évanescence de la maquette au brutalisme le plus affirmé, jouant de la référence toujours renouvelée à la basilique -contrefort portant chéneau de Simounet, contre murs-rideaux couleur verte de Niemeyer rappelant la couverture de cuivre du comble gothique restitué par Debret- ou à l’évocation de la cité médiévale dans les coursives enchâssées dans les îlots où les inflexions de façades resserrant les perspectives vers le monument.
La multiplicité des formes architecturales et l’ordonnancement des îlots ne traduisent pas la réalité morphologique du quartier. Contre toute attente, l’ondulation pittoresque des rues cache un urbanisme de dalle : celle-ci est implantée au niveau du terrain naturel et coiffe
un socle souterrain de parkings qui court sous les voiries et trottoirs et sur lequel s’élèvent indépendamment les îlots. Les conséquences se traduisent par les désagréments du genre: espace public chaotique ponctué de ruptures de niveaux, trémies de rampes de parking barrant l’espace, incapacité de plantations stigmatisée par les bacs à fleurs encombrant la rue, nappe de caillebotis des ventilations… L’accumulation des obstacles contribue à l’inconfort des espaces que la récente piétonnisation des chaussées n’a pas réussi à adoucir. Il en découle de complexes difficultés de gestion : hasardeuse coordination entre propriétaire de la dalle et propriétaire de son revêtement, ou encore inaccessibilité des réseaux publics cheminant indifféremment d’une propriété à l’autre, obligeant aujourd’hui certains exploitants à redoubler les équipements en façade des bâtiments : même confusion des statuts dans la prolongation indifférenciée des espaces publics au sein des îlots, et ce jusqu’aux coursives en étage distribuant les logements, ou dans la profusion de recoins et décrochements propices aux pires amoncellements que l’installation tente de pacifier. Dans cette schizophrénie, le quartier démontre une antériorité conceptuelle à l’”îlot ouvert”, incantation à succès de l’urbanisme contemporain qui n’a d’égale renommée que son contraire : la “résidentialisation”.
Il reste en définitive un quartier situé aux portes de Paris dont l’exemplarité demeure à méditer aujourd’hui. Son histoire nécessite un approfondissement bien supérieur à ses lignes pour en retracer la genèse et procéder à l’analyse architecturale qu’il mérite. Il conviendrait surtout d’en tirer un éclairage de nos pratiques actuelles. Dans le contexte plus ample du Grand Paris, il n’est pas sûr que les opérations soient beaucoup plus précautionneuses du déjà-là, que l’engagement des acteurs en faveur d’un urbanisme militant soit aussi désintéressé et surtout beaucoup plus “durable”. Dans ce registre, l’absence récurrente d’une pensée critique véritable de l’aménagement contemporain, docile à la programmation monofonctionnelle, inconsciente du découplage entretenu par le formalisme des projets et les problématiques de gestion dans le temps et, surtout, l’absence de toute prospective d’évolution des espaces, ne sont pas sans rappeler la brève longévité d’une production avec laquelle les acteurs de la ZAC Basilique tentaient de rompre. Réfléchir à la taille et à la géométrie du découpage foncier, à sa cohérence en termes de domanialité, de rapport entre sous-sol et élévation, à son articulation avec son environnement immédiat, doit favoriser le renouvellement de la ville sur elle-même et non son éradication programmée comme produit “jetable”. Pessimisme bien français ou principe de précaution, dans un contexte économique particulièrement tendu, où l’action publique est de plus en plus limitée en regard d’une initiative privée resserrée sur la rentabilité rapide des opérations, il est plus que jamais nécessaire d’envisager des formes urbaines aux capacités de mutabilité, de substitution partielle et mesurée, garantes de la pérennité de la ville et de son inscription dans le temps.
Plus que jamais, la conception des espaces non bâtis -drastiquement et systématiquement résumés aujourd’hui aux revêtements de sols, qu’ils soient herbeux ou non- nécessite un projet spatial en tant que tel, conditionnant les investissements et les programmes des constructions qui s’y adossent. Ce projet, politique par excellence, est laissé vacant par les instances publiques alors que l’initiative désormais privée de l’aménagement demeure inapte, par nature, à offrir généreusement des lieux dédiés à tous. Dans le “quartier Basilique”, la tentative d’édifier une ville pensée selon la relation intime entretenue entre l’enveloppe architecturale, la symbolique de son usage et l’espace public, telle qu’elle se révèle à la Renaissance, est encore à l’œuvre.
Bruno MENGOLI
ABF, Chef du STAP de la Seine Saint-Denis