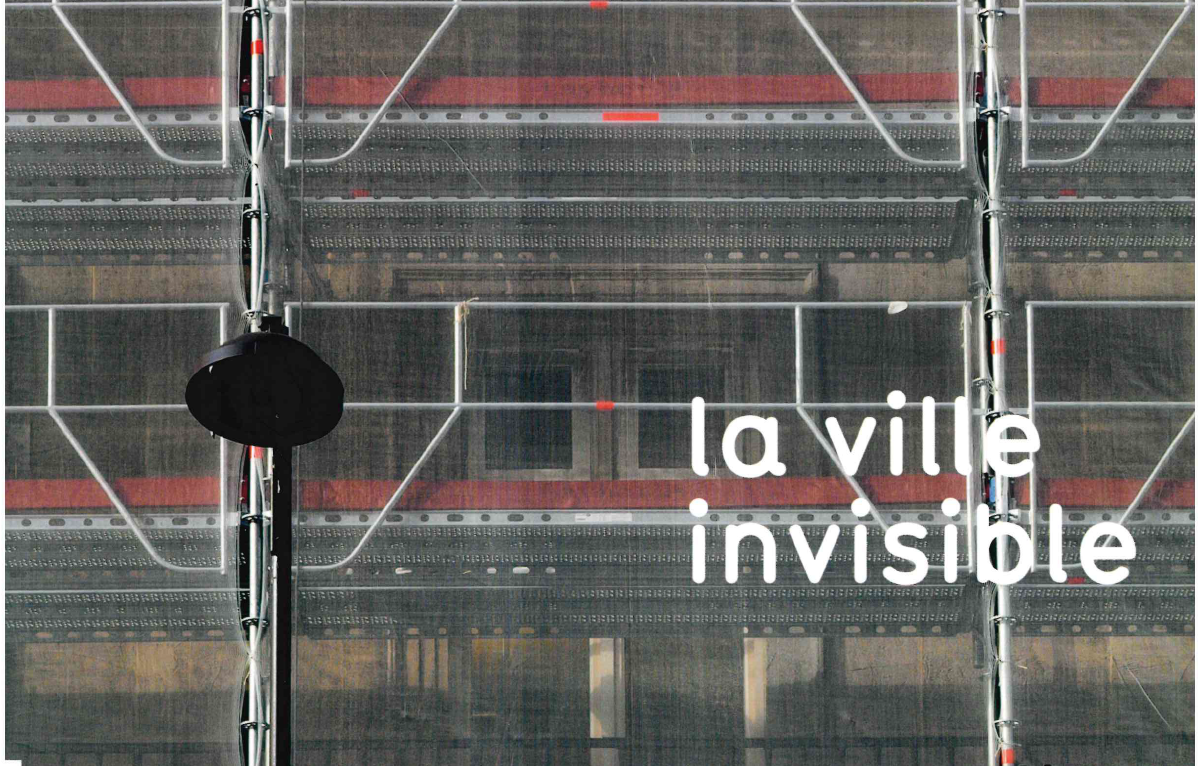L’habitat social est loin d’être reconnu unanimement comme objet patrimonial. Les divers regards qu’il a suscités depuis son apparition dans les années 1950 peuvent encore être discernés dans la cacophonie des débats actuels. De façon générale, il n’a pas bonne presse et une opinion commune semble le reléguer parmi les pires erreurs d’un passé proche.
Pour lire le début de l’article, cliquer ici
Ainsi, depuis un siècle, le ministère de la Culture n’a jamais hésité à appliquer la loi de 1913 à de nouveaux champs patrimoniaux, ni à utiliser la manière forte contre l’avis des propriétaires, cependant il s’avère réticent à s’attaquer à l’énorme massif architectural du logement social qui constitue pourtant une grande réserve pour le XXIe siècle et pour tout dire une “nouvelle frontière”.
Faut-il l’imputer uniquement à la crainte de perturber la délicate gestion des offices d’HLM ? À la crainte de l’État protecteur de s’engager inconsidérément dans un tonneau des Danaïdes de subventionnement et de faire exploser un budget qui ne suffit déjà plus à ses responsabilités actuelles ? À un divorce entre les professionnels et une opinion publique plus rétive ? À la relative inadéquation d’une loi conçue pour une protection maximale alors qu’il faudrait souvent accepter des ajouts significatifs et parfois lourds ? Ou finalement au manque de noblesse et de considération attaché à un habitat considéré comme pauvre et réservé aux pauvres ? Il y a sans doute un peu de vrai dans tout cet ensemble. La loi de 1913 n’est évidemment pas le meilleur outil si l’on doit, dans le projet de réhabilitation, accepter des démolitions, des mises aux normes, une remise en cause des circulations et des distributions de logements ou une nouvelle façade (fût-ce une façade arrière), bien que l’intervention de spécialistes compétents et la procédure des débats donnent toujours de bons résultats. In fine, tant que le logement social ne sera pas apprécié, y compris par ses habitants actuels, comme un habitat noble à ranger aux côtés du château de Versailles ou de la cathédrale de Chartres, la loi de 1913 aura du mal à s’y appliquer. En effet, si la loi de 1913 est un mécanisme légitimant, elle a aussi besoin d’une légitimité pré-existante pour pouvoir être envisagée. Or si une église, une demeure aristocratique ou bourgeoise disposent a priori d’une légitimité sociale favorisant la légitimation institutionnelle, il n’en est pas de même pour le logement social dont l’appréciation positive n’est encore le fait que de segments bien définis de l’opinion, architectes, historiens, qui ne tiennent pas vraiment les leviers de commande. Les sociologues Pinçon et Charlot ont bien montré comment la haute bourgeoisie savait protéger ses propres lieux en tenant les discours esthétiques et maintenant environnementaux les plus désintéressés en apparence. Un tel mécanisme d’auto-légitimation tenu par des couches sociales influentes se situe à des années-lumière de ce qui se passe dans l’habitat social. Dans ce secteur, dont la légitimité culturelle reste encore imprécise, balbutiante et conflictuelle, et dont la demande de légitimation ne vient pas des intéressés eux-mêmes mais de l’extérieur, l’application de la loi de 1913 est tout sauf évidente. Ce qui n’interdit pas évidemment de continuer le débat en essayant de faire basculer l’opinion des couches sociales éclairées et proches du pouvoir comme de celles qui habitent sur place et qui n’ont aucune idée qu’elles pourraient bien habiter un monument historique.
La protection Label XXe siècle
Ces difficultés expliquent a contrario le succès d’une procédure beaucoup plus souple, le label XXe siècle, créé par circulaire en 1999. Le Label XXe est une distinction sans aucune conséquence juridique et financière, accordée au terme d’une procédure d’instruction absolument identique à celle utilisée pour les immeubles inscrits au titre des MH. La Drac instruit les demandes, en faisant notamment procéder par ses services aux études historiques nécessaires, c’est-à-dire en faisant vérifier la pertinence du label au regard de la population d’objets envisagée (représentativité, exemplarité). Puis les propositions sont débattues devant la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Enfin, la liste définitive est promulguée par arrêté du préfet de région. Les immeubles labellisés reçoivent une plaque apposée à la façade, laquelle d’ailleurs bénéficie de mesures dérogatoires aux travaux d’isolation par l’extérieur envisagés sur le bâtiment, seule mesure concrète entraînée par l’obtention du label.
Absence d’effets juridiques ne signifie pas absence d’effets réels. Les services instructeurs ont coutume d’insister sur l’effet pédagogique du label. Les bâtiments ainsi distingués accèdent à un club rendu prestigieux par sa relative difficulté d’accès (on voit que l’administration sait copier les mécanismes du Rotary quand il le faut !). La notoriété acquise officiellement est censée freiner les velléités de destruction ou de mutation lourde, soit que le propriétaire des lieux, rendu fier de la distinction obtenue, préfère s’abstenir, soit que la notoriété ainsi reconnue mette les bâtiments sous la protection de l’opinion publique. Et je vois, quant à moi, un autre effet bénéfique de cette assimilation procédurale aux MH inscrits, celle d’habituer progressivement les services régionaux compétents à l’examen de cette nouvelle classe d’objets dans les mêmes formes que pour les MH habituels.
Au-delà même des effets propres à la distinction procurée par le label XXe , la simple et humble connaissance préalable déployée par les chercheurs universitaires où l’Inventaire décentralisé qui a nourri en amont la réflexion des services instructeurs, possède en elle-même des effets bénéfiques. Le premier effet de cette connaissance est de constituer un objet de savoir, de l’inventer au sens profond du terme (comme on parle de l‘“invention” d’un trésor). En le donnant à voir par l’opération d’inventorier, l’inventaire crée en fait du patrimoine. En le nommant et en le dégageant du diffus qui l’englue, il le fait passer à l’existence. Cette existence, désormais visible, est déjà une protection car, si l’on peut démolir ce qui n’est pas “vu”, il est beaucoup plus difficile de démolir ce qui est vu et identifié comme partie signifiante d’un corpus. Cela demande une décision expresse qui peut soumettre le décideur à l’accusation de vandalisme, voire à la censure du juge administratif pour erreur manifeste d’appréciation. Ces procédures de connaissance, d’inventaire et de label, ne développant pas d’effets juridiques, peuvent néanmoins secréter de considérables effets dans le seul ordre qui nous occupe, celui de la protection réelle.
Cette facilité d’instruction et cette apparente innocuité expliquent le succès de la procédure label XXe appliquée au logement social. Dès 2003, les Étoiles de Renaudie, à Givors, en bénéficiaient. Après avoir semblé être en retard, la région Île-de-France a frappé un coup de maître en inscrivant au label XXe, en 2008, quarante réalisations majeures, dont la cité de l’Étoile à Bobigny, les bâtiments de Lurçat à Saint-Denis, ceux de Renaudie à Ivry, de Jean Dubuisson à Rocquencourt, de Paul Chemetov à Vigneux et, globalement, les réalisations de Pouillon et d’Aillaud (sauf bien évidemment l’opération de la Noé à Chanteloup-les-Vignes).
Les autres instruments de protection ne semblent pas adaptés. La ZPPAUP, dénommée maintenant AVAP, peut rendre ponctuellement des services, comme à Villeurbanne où la cité des gratte-ciel, construite par Môrice Leroux dans les années 1930, a pu être réhabilitée très soigneusement grâce à cette procédure. Cependant, son élaboration extrêmement lente laisse tout loisir aux partenaires de se désengager dès qu’une difficulté survient. Il suffit de la préconiser là où les grands ensembles forment un quartier complexe et où une volonté des responsables est déjà solidement établie car elle offre alors un cadre souple à des évolutions négociées.
Le regard architectural
Le projet de réhabilitation doit être pleinement un projet d’architecture et donc il faut :
- le nourrir d’expertise et d’un débat tout au long de son élaboration, c’est ce que j’appellerai un “projet collectif continu” ;
- veiller à ce qu’il soit fondé sur une compréhension et une sympathie profonde envers le parti d’origine, c’est ce que j’appellerai un “projet respectueux” ;
- veiller à oser traiter les problèmes qui fâchent (ainsi la résidentialisation), c’est ce que j’appellerai un “projet courageux”.
Un projet collectif et continu
Il ne suffit pas qu’un projet de réhabilitation de grands ensembles soit signé par un architecte pour être assuré qu’il fasse le tour des problématiques architecturales. C’est se satisfaire à bon compte d’une simple obligation légale. Or depuis le lancement, il y a trente ans, de la politique de la Ville, tel semble bien être le cas : on prend tel quel le contenu architectural réel ou supposé du projet et on ne le discute plus. On peut supposer que le contenu strictement architectural joue un certain rôle dans le choix du maître d’ouvrage, mais c’est tout. Il n’y a pas de réel volet architectural dans le lancement des consultations. Et il n’y a plus ensuite d’intervention d’experts et, quand il y en a (ABF, missions d’inspection), elles sont ressenties comme des coups de force. Lors de l’intervention ultime et définitive qui est celle du comité d’engagement de l’ANRU, le critère financier domine de façon écrasante, à un point tel que tout contenu architectural, voire simplement spatial (localisation des démolitions par exemple) est tout bonnement absent des dossiers.
Dans sa solitude, sans le cadrage du débat, sans l’appui de l’expertise, l’architecte peut se laisser dominer par les pulsions de la création et de l’originalité. Il peut aussi, fût-ce inconsciemment, privilégier des solutions coûteuses, bénéfiques pour ses honoraires, à des solutions plus simples qui seraient préférables ; le maître d’ouvrage, théoriquement avare de ses deniers et contradictoirement soucieux de montrer qu’il “a fait quelque chose”, peut tout à fait entrer dans ces vues. C’est ainsi que l’on voit parfois, notamment pour les réhabilitations d’Aillaud, privilégier des revêtements de pôte de verre -qui ne déplaisaient certes pas à Aillaud- même là où, à l’origine, il avait conçu et longuement médité des revêtements en enduit peint. Le projet d’architecture a le plus souvent été sélectionné précisément en raison directe des démolitions et mutations imposées à la forme initiale. Qu’il y ait projet d’architecture ne suffit donc pas à traiter correctement les grands ensembles. Dans le fond, ce que l’on souhaite à l’habitat social, c’est d’être l’objet d’un processus collectif d’élaboration architecturale, comme cela se pratique en Allemagne pour tout projet urbain d’importance, et de bénéficier d’un apport continu d’expertise extérieure, comme cela se pratique en France pour les abords de MH, les secteurs sauvegardés ou même pour certains projets urbains comme Euralille, où le maître d’ouvrage Baïetto a œuvré pour un processus d’élaboration pluriel et continu.
Le ministère de la Culture, avec détermination et constance, et sans se laisser déstabiliser par les nombreuses rebuffades qu’il a essuyées au début, essaie depuis dix ans d’insuffler ce souci du débat et de l’expertise à tous les niveaux de l’instruction des projets de réhabilitation. Dans ce ministère ce sont d’abord et en premier les ABF qui tirent les sonnettes d’alarme, harcèlent les DDT (anciennes DDE) pour avoir les dossiers, importunent les préfets de leurs avis réservés où négatifs, tentent de s’immiscer dans des procédures là où l’architecture n’est pas la bienvenue. Les ABF, surtout dans leurs nouvelles générations (comme on le voit bien dans leur école de formation, à Chaillot, où les thèmes ANRU sont très prisés) constituent donc la première population d’experts que l’on rencontre sur cette question. Il en est d’autres, les historiens de l’art notamment, que la Culture peut mobiliser quand il le faut. Entre 2004 et 2008, le ministère de la Culture, allié à celui de l’Écologie, a lancé deux missions d’inspection sur Villetaneuse (Vieux pays de Renaudie) et Pantin (le Serpentin d’Émile Aillaud aux Courtillières) qui ont permis de rebattre les cartes et, grosso modo, de sauver les bâtiments en cause. Enfin, en 2006, le ministère a écrit avec l’ANRU une circulaire commune qui légitime l’intervention des ABF, même en dehors de toutes les protections patrimoniales classiques, et leur permet -il leur faut encore sur le terrain conquérir ce droit !- de donner des avis architecturaux sur les dossiers de réhabilitation. Quant au ministère de la Culture, il essaie de faire porter sa voix au conseil d’administration de l’ANRU. L’ANRU elle-même a beaucoup assoupli ses positions depuis plusieurs années et l’idéologie du tout-démolition y a nettement reculé, mais ses services instructeurs sont les DDT qui ont perdu toute expertise architecturale depuis les années 1980. La bataille de l’architecture n’est pas encore gagnée, mais elle n’est déjà plus perdue. Il va de soi qu’au-delà de la présence des troupes du ministère chargé de l’architecture dans l’instruction des dossiers, la bataille ne sera réellement gagnée que lorsque le débat architectural sur les grands ensembles aura su mobiliser l’ensemble des experts et des relais d’opinion.
Un projet respectueux
L’architecte qui a le bonheur de se colleter avec un projet de réhabilitation d’un grand ensemble doit d’abord être convaincu qu’il s’agit d’un des exercices architecturaux les plus stimulants. Il doit, ou devrait, commencer par se pénétrer de l’esprit du lieu, comprendre les intentions de l’architecte, sa vision de la ville. Il y avait en effet, du moins dans les meilleures réalisations, une certaine idée de l’habiter qui, pour n’être plus à la mode, n’en était pas moins réelle. Retrouver sous la gangue de l’usure, mais toujours présentes en puissance, les intentions urbaines d’Aillaud, de Labourdette et consorts, est un exercice intellectuel nécessaire et passionnant.
Confronté à la nécessité d’adapter et de mettre aux normes, il doit être capable de dire : si je peux toucher à ceci, en revanche je m’interdis de toucher à cela sous peine de porter atteinte à une qualité essentielle du lieu. La compréhension, l’amitié, l’empathie sont nécessaires à la réussite comme nous le montre péremptoirement par l’absurde ce qui a été commis à Chanteloup-les-Vignes. Confrontée au projet de démolition d’un quartier de Renaudie à Villetaneuse, la mission d’inspection avait identifié la volumétrie extérieure, le jeu puissant et contrasté des bétons à utiliser en structure ainsi que les galeries au rez-de-chaussée avec leurs portiques en V comme le minimum de ce qui devait être conservé. L’architecte d’opération est allé plus loin : il a conservé les terrasses plantées et trouvé le moyen de refaire des appartements fidèles à la typologie si reconnaissable de Renaudie. Le résultat est exceptionnel et le promoteur a vendu sur plans la totalité des appartements, y compris à des anciens locataires heureux de revenir sur place. La fidélité s’est révélée payante, infirmant tous les discours catastrophiques auparavant tenus sur cette réalisation. Sur les Courtillières, la mission d’inspection a tenu bon pour réduire les démolitions projetées à des dimensions comparables à l’ouverture déjà réalisée par Aillaud sur l’avenue des Courtillières et, surtout, pour maintenir à l’ensemble du serpentin un aspect parfaitement lisse, échappant ainsi aux lourds bardages projetés qui auraient transformé cette réalisation aérienne en une muraille maçonnée. Elle a également refusé tout bariolage arbitraire et proposé une stratégie de coloration inspirée des principes de Rieti et d’Aillaud.
IL est possible d’intervenir sur un grand ensemble si on en respecte le parti architectural d’origine et les caractéristiques ou éléments constitutifs les plus forts -ceux qui en constituent l’image.
Un projet courageux
Le projet doit avoir également le courage de traiter les points qui fâchent car, sous peine d’en arrêter l’évolution, on condamne le plus sûrement les grands ensembles à devenir des lieux indignes et donc voués à la démolition. Le premier des problèmes à devoir être impérativement traité est celui de la sécurité des personnes et des biens. La réponse est dite souvent “résidentialisation” : elle consiste à sécuriser les entrées de bâtiments en les agrandissant, en les ouvrant au jour naturel ou en les dotant de sas. Dans l’habitat proliférant, la résidentialisation consiste à condamner les circulations mi-publiques mi-privées telles qu’on les trouve chez Renaudie, et qui peuvent amener le “visiteur extérieur” venant de la rue jusqu’à la porte du logement sans aucun sas intermédiaire. Il est exact qu’un des points essentiels de l’utopie sociale des années 1970 est ainsi remis en cause et que la résidentialisation d’un bâtiment de Renaudie, telle celle menée par l’AOTEP sur un des bâtiments à Villetaneuse, est une atteinte sérieuse au parti architectural. Il faut en accepter le principe, quitte à en négocier au mieux l’aspect architectural, voire la réversibilité. C’est ainsi, également, qu’à propos du projet de mise en sécurité des Courtillières et de remise en cause des espaces semi-publics du rez-de-chaussée, la mission d’expertise en avait à contrecœur accepté le principe, mais avait refusé la solution proposée, trop pesante pour préserver la légèreté initiale. Claude Parent, qui n’est pas vraiment amateur de grands ensembles, a évoqué en 2007, dans la brochure déjà citée éditée par le ministère de la Culture, quelques recettes pour la mise en sécurité. Il préconise notamment un système de communication obligatoirement transparent et dégagé des façades où même ouvert à l’air libre. Ce système, conjugué avec une hauteur limitée à R+3, est précisément appliqué dans les HLM construites à Montpellier depuis trente ans qui font l’économie des ascenseurs. Il propose également la mise en place d’impasses pour “dérouter” les fuyards, ce qui renforce mon propos sur l’inutilité des ouvertures sécuritaires, voire leur nocivité. Mais ces idées ne sont pas toujours applicables aux grands ensembles existants.
Un autre problème à traiter sans tabou est celui du respect des partitionnements intérieurs. Il faut savoir les abandonner car les F3 ne font plus 35 m2, et les modes de vie ne sont plus les mêmes qu’en 1960. D’autant que les plans sont souvent largement répétitifs et qu’il vaut mieux, lors d’une réfection générale, isoler par l’intérieur que par l’extérieur. La mission d’inspection l’avait admis sans détour pour les Courtillières, ce qui n’empêche pas de faire du “à la manière de” comme on l’a réussi à Villetaneuse où les nouveaux appartements reprennent les principes distributifs de Renaudie.
IL serait souhaitable enfin qu’une sensibilité paysagère aiguë vienne enrichir les projets de réhabilitation. Les espaces verts des grands ensembles ne sont pas toujours aussi nuls que l’on veut bien le dire et il en est même de remarquables, comme les parcs et les jardins d’Émile Aillaud à Pantin où à la Grande Borne, qui doivent être préservés comme des chefs-d’œuvre paysagers du XXe siècle. De façon générale, si les bâtiments des grands ensembles ont parfois bien mal vieilli, il n’en est pas de même pour les arbres qui ont atteint, eux, en quarante ou cinquante ans, une belle allure. Un véritable plan de paysage, un “urbanisme paysager”, pour reprendre l’expression de Caroline Stefulesco dans son livre de 1988, unifierait des espaces parfois disjoints et saurait redonner des repères visuels et surtout de la dignité. C’est un aspect des rénovations qui est malheureusement souvent traité à l’économie, et qui d’ailleurs ne peut donner son plein effet que des décennies plus tard, hors des échéances électorales.
Le logement social des Trente Glorieuses sera sauvé dans l’exacte mesure où le développement durable et la nécessité écologique seront pris en compte dans les décisions. Apparemment il est paradoxal de l’affirmer pour un habitat qui a été construit dans l’urgence et souvent hors de toute planification urbaine préalable. Il serait pourtant bien plus coûteux de le démolir que de l’adapter. Il est déjà là, et sa simple existence est une économie d’investissement pour l’avenir. Construit il y a cinquante ans aux limites de la périphérie, il est maintenant au cœur de la zone agglomérée. Il constitue une réserve foncière pour des densifications futures. Il est devenu en un demi-siècle un lieu d’histoire(s) et de patrimoine. En Seine-Saint-Denis, le patrimoine et l’histoire du lieu, ce sont la basilique Saint-Denis, les Courtillières à Pantin, la cité de l’Étoile à Bobigny, les réalisations de Lods à Drancy, et cette légitimité, qui n’existait pas il y a un demi-siècle, est le meilleur point d’accroche qui soit pour un nouveau développement économique ancré dans son territoire. Ce patrimoine est une chance, il faut la saisir.
À LIRE :
Les grands ensembles une architecture du XXe siècle, ouvrage collectif sous la direction du ministère de la Culture, Dominique Carré éditeur 2011.
Francis CHASSEL
Inspecteur général honoraire, ministère de la Culture